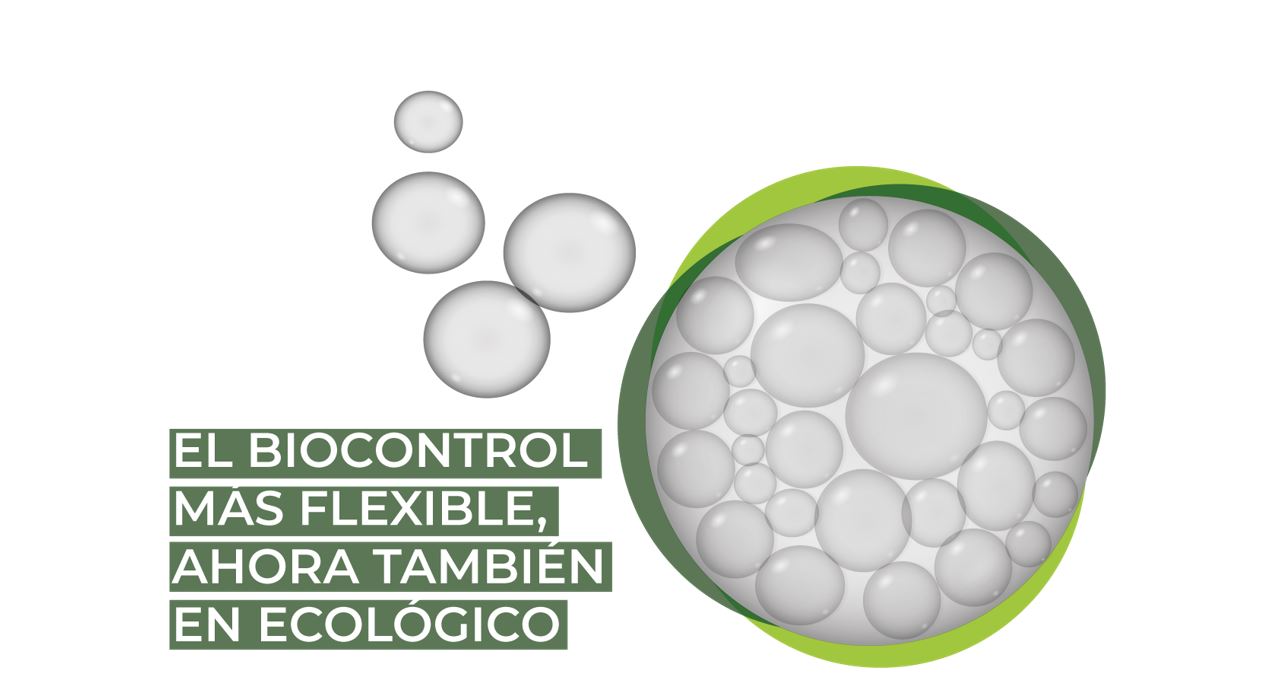Le lac Titicaca, partagé par Bolivie et Perú, subit une dégradation alarmante. La pêche presque disparue et la pollution croissante affectent non seulement les écosystèmes, mais également les communautés locales. Ce panorama met en lumière l’urgence d’agir face à une crise qui menace de devenir irréversible.
Cohana, le lac mineur et une décennie décisive
Une dégradation alarmante du lac Titicaca
Le lac Titicaca, qui se trouve à cheval entre Bolivie et Pérou, est en proie à une dégradation profonde. Les filets de pêche se font de plus en plus rares dans les eaux peu profondes, et au sein du lac mineur, l’activité piscicole a presque disparu, poussant de nombreuses familles à quitter la région. Ce contexte est aggravé par des conditions climatiques sèches récentes, qui nuisent à la fois aux écosystèmes et aux moyens de subsistance des habitants.
Les différences au sein de ce vaste plan d’eau sont marquées : le lac mineur, d’une superficie d’environ 2 000 km² avec des profondeurs variant entre 2 et 4 mètres, ne mesure plus que 50 centimètres à des endroits comme la baie de Cohana. En revanche, le lac majeur, qui couvre plus de 6 000 km², conserve des profondeurs et une stabilité plus importantes. Ces deux masses d’eau sont séparées par le détroit de Tiquina, un véritable barrière physique et écologique.
Cohana et le lac mineur : impacts visibles sur les communautés et les îles
Cohana est au cœur de la problématique, car c’est ici que le fleuve Katari déverse des eaux usées provenant d’El Alto (qui compte presque un million d’habitants) et de la voisine Viacha. Dans cette partie du lac mineur, où la zone la plus profonde n’atteint guère que 40 mètres, les eaux sont troubles, les zones marécageuses se multiplient, et une couche verte de surface, nourrie par des nutriments, favorise l’épanouissement de microalgues.
Au fond du lac, un matériau noir, visqueux et collant s’accumule, se fixant aux totoras. Cette plante, essentielle pour l’alimentation du bétail et l’artisanat local, présente désormais une croûte noire sur ses tiges, que les animaux évitent, impactant ainsi l’économie familiale. Il n’y a pas si longtemps, des réseaux de pêche et des canoës cherchant des espèces natives comme le karachi ou le mauri étaient courants, mais aujourd’hui, cette image a presque disparu. Sur plusieurs rives, l’odeur est omniprésente et l’eau est devenue plus trouble, symptômes d’une perte rapide de la qualité environnementale affectant également les oiseaux et les amphibiens.
Les leaders communautaires des populations riveraines soulignent que la vie quotidienne a été complètement perturbée : les jeunes sont partis car la pêche n’est plus un revenu fiable et les emplois alternatifs se font rares. Une sensation commune émerge : le lac « ne produit plus » et la contamination se propage de Cohana vers d’autres communautés, amplifiant les dommages.
L’île de Sicuya, la plus petite du Titicaca avec moins de 300 habitants, illustre parfaitement ce changement. Sa seule école compte 27 élèves, et les soins médicaux disponibles sont primaires. L’accès à l’île se fait uniquement par bateau, et de nombreuses maisons restent vides une grande partie de l’année. Dans son environnement, l’eau est sombre et les totoras sont souillées ; les habitants constatent que la pêche locale a pratiquement disparu en raison de la dégradation de l’habitat.
De plus, avec les sécheresses récentes, le niveau de l’eau a baissé de manière préoccupante dans les zones peu profondes du lac mineur. Cette diminution, associée aux rejets provenant des affluents, accélère le déclin des zones côtières les plus proches des activités humaines.
Causes, risques et interventions urgentes
Des recherches menées par l’Autorité Binational du Lac Titicaca attribuent ce problème à une combinaison de décharges urbaines, de rejets industriels et d’activités minières. Des nutriments comme le phosphore, souvent présent dans les détergents, stimulent la croissance de microalgues qui, une fois décomposées par des bactéries, diminuent l’oxygène dissous et génèrent du sulfure d’hydrogène, un composé capable de tuer poissons, grenouilles et oiseaux.
Les experts avertissent qu’il reste peu de temps pour agir : si aucune action n’est entreprise dans un délai de dix ans, rétablir la situation pourrait devenir techniquement impossible. Ils soulignent que la zone littorale est la plus vulnérable en raison de sa proximité avec les villes, l’agriculture, l’élevage et l’industrie, et qu’il est urgent d’attaquer à la source le problème du phosphore.
Les mesures proposées incluent l’achèvement de quatorze stations de traitement des eaux usées pour renforcer la station principale, le déploiement de « mini-stations » mobiles de la taille de conteneurs, la construction d’un grand canal de dérivation pour intercepter les flux contaminés avant qu’ils n’atteignent le lac et la création de lagunes peu profondes avec des totorales pour agir comme des filtres naturels de nutriments.
En plus de l’infrastructure, il est recommandé de freiner l’expansion désordonnée d’El Alto vers le lac par une planification urbaine stricte et de promouvoir un tourisme responsable qui contribue à la conservation. Des expériences menées dans le lac Léman (en Suisse) et dans le lac Paranoá (au Brésil) montrent qu’il est possible de restaurer des plans d’eau fortement dégradés au moyen de mesures soutenues sur plusieurs années.
Actuellement, les progrès restent limités : la modernisation de la principale station de traitement accuse des retards et divers projets n’ont pas atteint leur efficacité. Les organisations de la société civile signalent des lacunes en matière de mitigation et demandent d’accélérer les investissements et la supervision, étant donné que la dégradation du lac mineur se poursuit sans relâche.
Une dimension sociale et sanitaire croissante est également constatée. Des initiatives éducatives comme « Le Titicaca nous raconte » rappellent que les affluents, y compris le fleuve Coata sur le côté péruvien, déversent dans le lac des eaux non traitées. Cela expose les habitants à des risques de maladies gastro-intestinales, de dommages hépatiques ou rénaux, et d’éventuels effets neurologiques chez les enfants, associés aux métaux lourds, renforçant ainsi l’urgence d’implanter des stations de traitement, de favoriser le recyclage et de mener des campagnes de sensibilisation à la protection de l’eau.
Le tableau qui se dessine montre un lac mineur étouffé, avec Cohana comme baromètre : la combinaison de décharges et de sécheresses réduit la pêche, accélère la migration et nuit à la totora. Il reste une courte période pour couper l’approvisionnement en phosphore à la source, terminer le traitement des eaux, organiser le territoire et impliquer la population dans des solutions concrètes, avant que la dégradation ne devienne techniquement irréversible.
Mon avis :
La contamination du lac Titicaca, exacerbée par des apports urbains et industriels, menace la biodiversité et les moyens de subsistance locaux. Si des efforts de traitement des eaux et de gestion urbaine émergent, les résultats restent limités. Une action rapide est cruciale pour éviter une dégradation irréversible des écosystèmes.
Les questions fréquentes :
Quelles sont les principales causes de la pollution du lac Titicaca ?
La pollution du lac Titicaca est principalement attribuée à des vertiges urbains, des décharges industrielles et des activités minières. Des nutriments comme le phosphore, souvent présents dans les détergents, favorisent la prolifération de microalgues, réduisant l’oxygène dissous dans l’eau et créant des conditions mortelles pour de nombreuses espèces aquatiques.
Comment la pollution affecte-t-elle les communautés vivant autour du lac ?
Les communautés vivant autour du lac souffrent de la dégradation de l’écosystème, ce qui impacte leurs moyens de subsistance. La pêche, qui était une source de revenus importante, a presque disparu dans certaines zones, poussant de nombreuses familles à quitter la région. La qualité de l’eau a également chuté, rendant la vie quotidienne difficile.
Quels sont les risques pour la santé liés à la pollution du lac ?
La pollution du lac Titicaca pose des risques sanitaires croissants. Les eaux contaminées peuvent provoquer des maladies gastro-intestinales, ainsi que des dommages hépatiques ou rénaux, particulièrement chez les enfants. La présence de métaux lourds dans l’eau renforce l’urgence d’initiatives éducatives et de mesures sanitaires.
Quelles solutions sont envisagées pour remédier à la crise du lac Titicaca ?
Pour remédier à la crise, plusieurs mesures sont proposées, telles que la construction de stations de traitement des eaux usées, de mini-stations mobiles, et de canaux de dérivation pour intercepter les eaux contaminées. En parallèle, il est crucial de stopper l’expansion urbaine désordonnée et de promouvoir un tourisme responsable pour contribuer à la conservation du lac.