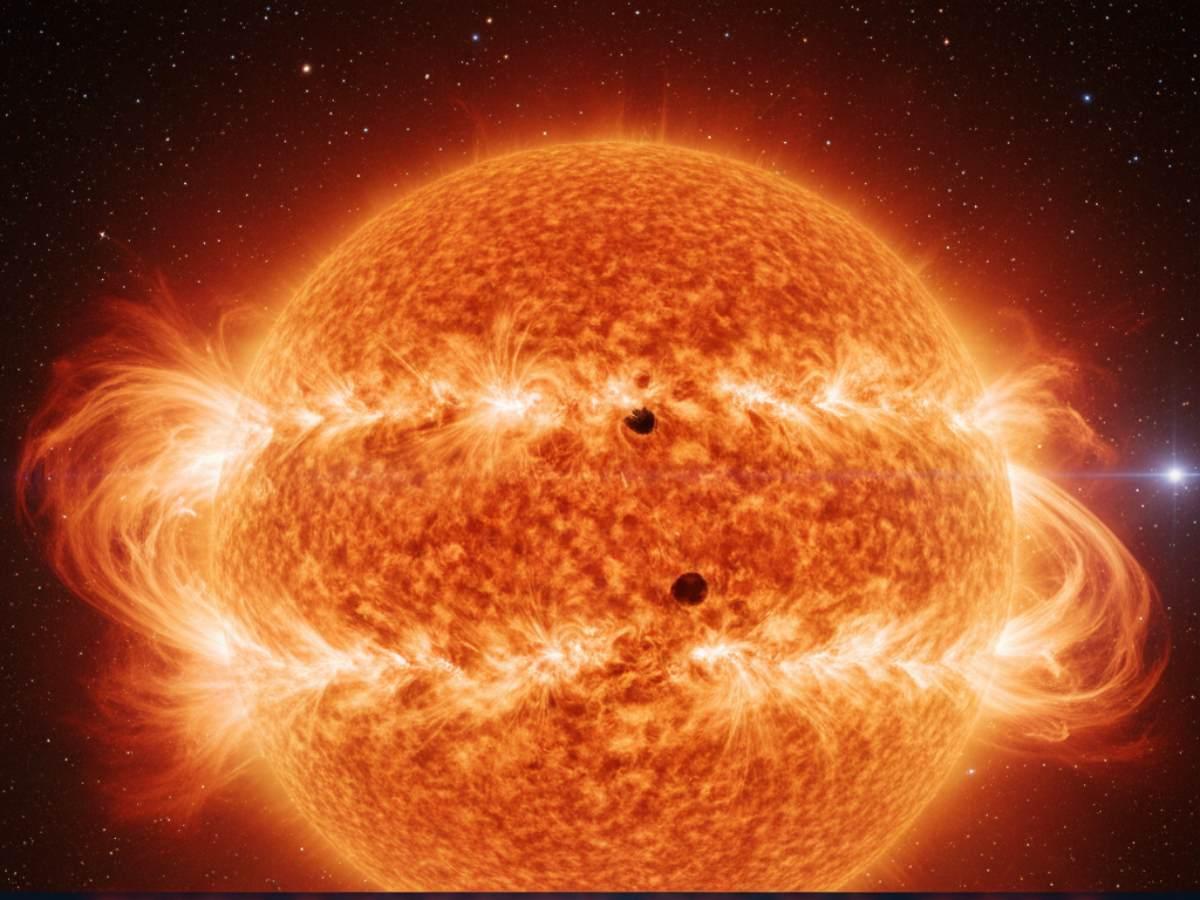La France et l’Espagne plongent dans le cœur du débat nucléaire, avec des enjeux cruciaux sur les prolongations de vie et les coûts. Pendant qu’à l’échelle européenne, le projet de tripler la capacité nucléaire d’ici 2050 se dessine, des questions sur la compatibilité avec les énergies renouvelables se dressent.

Espagne : coûts, déchets et calendrier sous la loupe
Le rapport « L’Avenir de l’Énergie Nucléaire en Espagne » de la *Fundación Renovables* soutient que la remise à niveau d’un réacteur pour prolonger sa durée de vie pourrait coûter entre 25 % et 50 % de ce qu’exigerait une nouvelle centrale, avec des fourchettes totales allant de 14 000 à 35 000 millions d’euros, ce qui est jugé démesuré par rapport à des alternatives moins coûteuses et plus rapides.
Ce rapport compare également les prix : en Espagne, le coût de l’énergie nucléaire se situe au-dessus de 65 €/MWh, par rapport à 24-43 €/MWh pour l’éolien et le solaire. À l’échelle internationale, le LCOE estimé pour le nucléaire atteint 173 $/MWh, bien au-dessus de ceux des énergies renouvelables mentionnées.
Dans ce contexte, la *Fundación Renovables* remet en question l’argument selon lequel le manque de compétitivité de l’énergie nucléaire serait dû à la fiscalité. Elle souligne la nécessité d’**internaliser toutes les externalités** pour éviter de futurs coûts pour les consommateurs et l’État.
Parallèlement, le document indique que prolonger la durée de vie des centrales constituerait une altération de la planification énergétique visant à décarboniser et électrifier l’économie, avec des impacts économiques, sociaux et environnementaux significatifs.
Prolongations de vie : Almaraz ouvre la voie et ANAV attend son tour
La centrale d’**Almaraz** a officiellement demandé une prolongation de fonctionnement. La ministre pour la Transition Écologique, *Sara Aagesen*, a indiqué que le gouvernement analyse la demande avec deux lignes directrices : ne pas transférer les coûts aux consommateurs et garantir la sécurité nucléaire.
À *Catalogne*, l’*ANAV* défend que les groupes de **Ascó I et II** et **Vandellòs II** peuvent fonctionner « encore de nombreuses années », visant au moins 50 ans. La société, participant avec *Endesa* et *Iberdrola*, souligne des investissements annuels de 30 millions par réacteur pour maintenir la fiabilité des installations.
Les fermetures théoriques restent fixées à octobre 2030 (Ascó I), septembre 2032 (Ascó II) et février 2035 (Vandellòs II). Pour l’heure, aucune demande officielle n’a été faite pour prolonger leur opération, bien que le secteur considère la prolongation d’Almaraz comme un signal positif.
Sur le plan législatif, le Plénum du Congrès a rejeté la suppression de la « date d’arrêt définitif » d’Almaraz, Ascó I et Cofrentes, maintenant ainsi les dates de fermeture figurant dans la planification actuelle.
Du point de vue juridique, il souligne que des décisions comme l’extension de vie d’Almaraz relèvent de la discrétion du gouvernement, conformément à la doctrine établie dans le cas de Garoña.
Opération et réseau : tensions avec les renouvelables et stabilité du système
L’analyse précitée souligne que les réacteurs espagnols constituent un obstacle à l’expansion des énergies renouvelables du fait de leur rigidité opérationnelle. Pendant les périodes de haute production éolienne et solaire, l’incapacité à moduler rapidement la puissance nucléaire, combinée à un manque de stockage suffisant, aurait engendré des congestions et des pertes de renouvelables dans le réseau.
Il est également ajouté que le nucléaire ne possède pas de capacité technique pour stabiliser le réseau face à des surtensions, selon des communications des compagnies électriques à *Red Eléctrica*. En revanche, les énergies renouvelables avec technologie de formation en grille pourraient jouer ce rôle, un outil en attente de réglementation et déjà opérationnel dans des pays comme *le Portugal*.
Cette analyse se connecte au débat concernant le mix énergétique futur et les inefficacités qui émergeraient de la blocage des renouvelables en période d’excédent. Selon cette vision, la priorité demeure l’accélération du stockage, la gestion de la demande et l’amélioration du réseau pour intégrer une plus grande production d’énergie propre.
Bien que le débat public sur le rôle de chaque technologie dans la sécurité d’approvisionnement se poursuive, les décisions concernant les prolongations dépendraient de critères de sécurité, de coût et de compatibilité avec des objectifs climatiques.
Quoi qu’il en soit, l’intégration opérationnelle de l’énergie nucléaire dans un système à forte composante renouvelable exige une planification fine pour éviter les pertes, accroître la flexibilité globale et minimiser les coûts pour le consommateur.
Europe : entre le « renouveau » et le statu quo
Le discours sur le « renouveau nucléaire » est en désaccord avec les données récentes : de 2010 à 2024, la puissance nucléaire mondiale est passée de 370,9 GW à 375,5 GW, affichant une augmentation de 1,2%. Dans le même intervalle, l’éolien et le solaire ont enregistré une croissance de 262%, atteignant 4 448 GW.
Dans l’Union Européenne, la puissance nucléaire a chuté de 120 GW en 2010 à 97 GW en 2024 (une baisse de 19,5 %), en raison de la fermeture de l’Allemagne et du blocage de la flotte française. De plus, plus de 78% des réacteurs européens appartiennent à des entreprises étatiques ou publiques, ce qui reflète la complexité d’investir dans cette technologie.
Cependant, l’engagement mondial à tripler la capacité nucléaire d’ici 2050 attire de nouveaux partisans (des pays comme *le Sénégal* et *le Rwanda* ayant récemment rejoint le mouvement). L’*Association Nucléaire Mondiale* affirme que cet objectif est réalisable si les promesses se concrétisent ; l’*AIEA*, pour sa part, envisage jusqu’à 992 GW dans son scénario optimiste pour le milieu du siècle.
*La Chine* impose son rythme avec de nombreuses constructions de réacteurs et des délais plus courts ; hors de son écosystème, les projets accumulent des retards et des surcoûts : *Vogtle* aux États-Unis a été mis en service avec des délai et coûts doublés, tout comme *Hinkley Point C* (Royaume-Uni), qui subit également des retards et des hausses de coûts.
La clé pour l’Europe résidera dans l’amélioration de l’exécution industrielle et la standardisation des conceptions si elle souhaite retrouver du dynamisme, tout en adaptant sa politique énergétique à l’intégration massive des énergies renouvelables.
L’Allemagne rouvre le débat : suspension du démantèlement et focus sur les SMR
Après l’extinction nucléaire de 2023, le nouveau gouvernement de *Berlin*, dirigé par *Friedrich Merz*, a réouvert la discussion et a temporisé le démantèlement des centrales, tout en évaluant comment réactiver certains réacteurs ou orienter vers des réacteurs modulaires de petite taille (SMR).
La ministre de l’Économie, *Katherina Reiche*, a repris les contacts dans des forums européens pronucléaires, et l’**AIEA** perçoit qu’Allemagne étudie **sérieusement** son retour. Le plan national de fusion prévoit des investissements jusqu’à 5 000 millions d’euros pour promouvoir des usines pilotes et industrielles au cours de cette décennie.
Concernant les SMR, le gouvernement a demandé un rapport à *BASE* et à l’Institut *Fraunhofer*, en collaboration avec des experts, pour analyser la viabilité économique et réglementaire et leur intégration dans le mix, avec des conclusions préliminaires attendues pour le printemps 2026.
Politiquement, le gouvernement n’envisage pas de dépendre totalement de la nucléaire, mais explore une récupération contrôlée avec un accent sur la technologie, parallèlement à la classification favorable de *Bruxelles* en matière de durabilité.
SMR : maturité technologique et coûts sous surveillance
Le débat en Europe, et surtout en Allemagne, porte sur la capacité de ces conceptions à atteindre une standardisation, des économies d’échelle et une certitude réglementaire suffisantes pour réduire les coûts et entrer véritablement dans la hiérarchie énergétique.
À court terme, leur déploiement massif semble complexe en raison des délai de développement et de la nécessité de renforcer les chaînes d’approvisionnement, bien que plusieurs gouvernements souhaitent maintenir cette option ouverte comme complément aux énergies renouvelables et au stockage.
Dans l’ensemble, l’avenir du nucléaire en Europe dépendra de sa capacité à aligner coûts, délai et sécurité avec les objectifs climatiques, tout en accélérant l’électrification, où les énergies renouvelables affichent actuellement une avance.
Alors qu’Espagne prend des décisions sur les prolongations et que l’Europe jauge ses ambitions, la clé sera de peser coûts, déchets, flexibilité et risques du parc nucléaire par rapport à la rapidité et au prix des énergies renouvelables, ainsi qu’à l’impératif de garantir un approvisionnement sûr, compétitif et conforme aux objectifs climatiques.
Mon avis :
La situation de l’énergie nucléaire en Espagne et en Europe est complexe. Bien qu’elle offre une capacité de base, son coût en Espagne est supérieur à 65 €/MWh, contre 24-43 €/MWh pour les renouvelables. Les projets nucléaires rencontrent des retards et des surcoûts, tandis que des pays plaident pour une augmentation de 992 GW d’ici 2050, ce qui soulève des questions sur la faisabilité et la durabilité du mix énergétique face à la transition vers des solutions renouvelables.
Les questions fréquentes :
Quel est l’état actuel de l’énergie nucléaire en Espagne et en Europe ?
La question de l’énergie nucléaire est redevenue cruciale en Espagne et en Europe, avec des décisions concernant les prolongations de vie, les coûts et l’intégration avec les énergies renouvelables. En Espagne, des demandes de prorogation, des rapports critiques et des votes parlementaires influencent le calendrier de fermeture des centrales. Au niveau international, de nombreux pays soutiennent l’objectif de tripler la capacité nucléaire d’ici 2050, bien que des défis restent en matière de retard et de surcoûts, surtout en dehors de la Chine.
Quels sont les coûts associés au prolongement de la vie des centrales nucléaires ?
Le rapport « Le Futur de l’Énergie Nucléaire en Espagne » estime que le coût de la remise à niveau d’un réacteur pour prolonger son fonctionnement pourrait se situer entre 25 % et 50 % du prix d’une nouvelle centrale, avec un total allant de 14 à 35 milliards d’euros. De plus, le coût de l’énergie nucléaire en Espagne est supérieur à 65 €/MWh, tandis que l’énergie éolienne et photovoltaïque se situe entre 24 et 43 €/MWh, rendant la nucléarisation moins compétitive en comparaison.
Quelles sont les implications de la poursuite de l’activité nucléaire pour l’environnement et la société ?
Prolonger la vie des centrales nucléaires pourrait perturber la planification énergétique vers la décarbonisation et l’électrification de l’économie, avec des impacts significatifs sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Les experts soulignent la nécessité d’intégrer toutes les externalités pour éviter des coûts futurs pour les consommateurs et les finances publiques.
Comment la technologie des petits réacteurs modulaires (SMR) pourrait-elle influencer l’avenir de l’énergie nucléaire en Europe ?
La discussion autour des SMR en Europe soulève des questions sur leur capacité à atteindre une standardisation, des économies d’échelle et la certitude réglementaire nécessaires pour réduire les coûts. Bien que leur déploiement à grande échelle paraisse complexe à court terme, les gouvernements restent ouverts à cette option comme complément aux renouvelables et au stockage, ce qui pourrait redéfinir le rôle de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique à l’avenir.