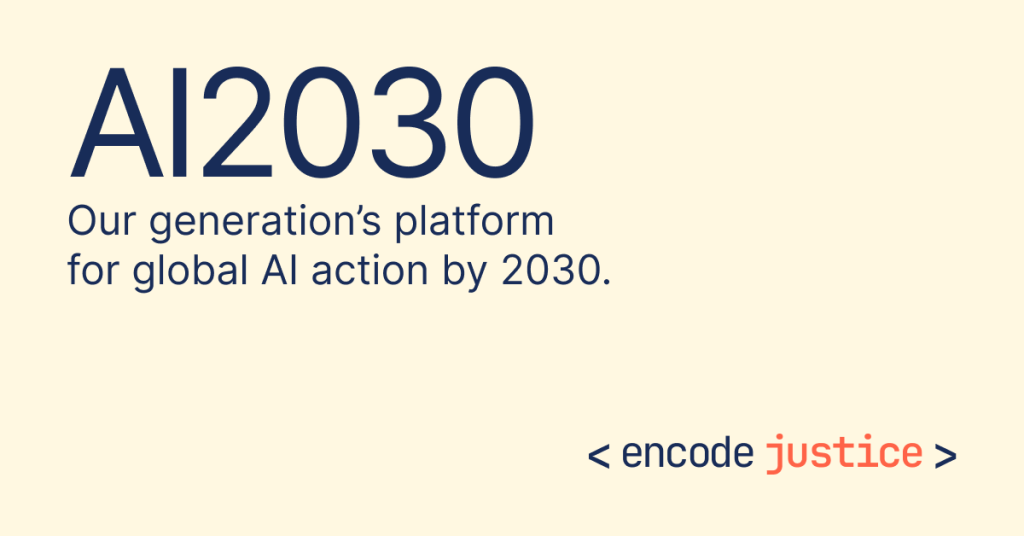Sundar Pichai met en garde contre l’irrationalité des investissements massifs en intelligence artificielle
Le patron d’Alphabet, Sundar Pichai, a lancé un avertissement retentissant concernant l’état actuel du marché de l’intelligence artificielle. Lors d’une récente intervention à la BBC depuis les bureaux californiens de Google, le dirigeant a exprimé ses inquiétudes quant à la frénésie qui s’est emparée du secteur technologique. Selon lui, malgré le caractère « extraordinaire » de la croissance des investissements dans l’IA, une certaine « irrationalité » caractérise désormais cette ruée vers l’or numérique. Cette mise en garde intervient alors que la valorisation des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle atteint des sommets vertigineux, alimentée par une course effrénée des investisseurs désireux de ne pas manquer le train de cette révolution technologique.
Les préoccupations exprimées par le PDG de Google ne sont pas anodines. Elles reflètent une réalité économique où les montants investis dans l’IA ont explosé de manière spectaculaire au cours des derniers mois. Les géants technologiques rivalisent d’ardeur pour développer leurs infrastructures, recruter les meilleurs talents et déployer des modèles toujours plus performants. Cette dynamique rappelle dangereusement les bulles spéculatives du passé, comme celle des dot-com au tournant du millénaire, où l’euphorie collective avait conduit à une surévaluation massive avant un effondrement brutal. Les développements récents dans l’écosystème Google illustrent parfaitement cette tendance à l’accélération des investissements technologiques.
La déclaration de Pichai prend un relief particulier lorsqu’il reconnaît que même Google, malgré sa position dominante et ses ressources considérables, ne serait pas épargné par un éventuel éclatement de la bulle. « Aucune entreprise ne serait épargnée, y compris nous », a-t-il affirmé sans détour. Cette franchise contraste avec le discours habituellement optimiste des dirigeants du secteur technologique. Elle témoigne d’une conscience aiguë des risques systémiques qui pèsent sur l’ensemble de l’industrie. Le marché de l’intelligence artificielle représente désormais des centaines de milliards de dollars d’investissements, avec des entreprises dont la valorisation repose essentiellement sur des promesses futures plutôt que sur des bénéfices immédiats.
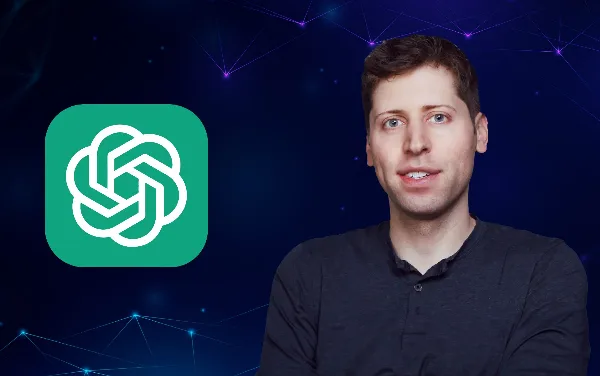
Les signaux d’alarme d’une surchauffe du marché technologique
Plusieurs indicateurs suggèrent que le secteur de l’intelligence artificielle pourrait effectivement se trouver dans une phase de surchauffe. Les valorisations de startups spécialisées atteignent des niveaux qui auraient semblé impensables il y a quelques années. Des entreprises sans revenus substantiels lèvent des fonds à des évaluations dépassant le milliard de dollars, simplement parce qu’elles travaillent sur des technologies liées à l’IA. Cette dynamique ressemble étrangement aux excès observés lors de précédentes bulles spéculatives, où l’engouement collectif l’emportait sur l’analyse rationnelle des fondamentaux économiques.
Les investisseurs institutionnels et les fonds de capital-risque se livrent à une véritable guerre des enchères pour sécuriser leur participation dans ce qu’ils perçoivent comme la prochaine révolution industrielle. Cette compétition féroce pousse mécaniquement les prix à la hausse, créant un cercle vicieux où chaque nouvelle levée de fonds justifie des valorisations encore plus élevées. L’évolution des algorithmes comme celui de Google Discover montre comment l’intelligence artificielle transforme progressivement les outils numériques, mais cette transformation justifie-t-elle les sommes colossales actuellement investies?
| Indicateur de risque | État actuel | Niveau d’alerte |
|---|---|---|
| Valorisations | Croissance de 300% en 18 mois | Élevé |
| Ratio investissement/revenus | 15:1 en moyenne secteur | Critique |
| Concentration des capitaux | 80% vers 10 entreprises majeures | Modéré |
| Durée jusqu’à rentabilité | 5-7 ans estimés | Élevé |
- Multiplication des annonces spectaculaires : chaque semaine apporte son lot de déclarations grandiloquentes sur les capacités futures de l’IA
- Course aux partenariats stratégiques : les entreprises s’associent frénétiquement pour ne pas rester à l’écart de la dynamique
- Détournement massif de ressources : des budgets colossaux sont réalloués vers l’IA au détriment d’autres activités établies
- Émergence d’un vocabulaire marketing : tout produit se voit désormais estampillé « propulsé par l’IA » pour justifier des prix premium
- Pression sur les dirigeants : les cadres subissent une pression intense pour montrer leur engagement dans la course à l’IA
L’impact énergétique colossal de l’intelligence artificielle compromet les objectifs climatiques
Au-delà des considérations purement financières, Sundar Pichai a également soulevé une problématique cruciale souvent négligée dans l’enthousiasme ambiant : la consommation énergétique phénoménale de l’intelligence artificielle. Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie, l’IA représentait déjà 1,5% de la consommation mondiale d’électricité l’année dernière. Ce chiffre, qui pourrait sembler modeste à première vue, est en réalité considérable et ne cesse de croître à un rythme alarmant. Pour mettre cela en perspective, cette consommation équivaut à celle de pays entiers de taille moyenne, et les projections suggèrent un doublement, voire un triplement de cette proportion dans les années à venir.
Le PDG de Google a d’ailleurs reconnu avec une franchise notable que ces besoins énergétiques « immenses » affectent directement les ambitions climatiques de son entreprise. Alphabet, qui s’était fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030, se trouve désormais confronté à un dilemme de taille. « Le rythme auquel nous espérions progresser sera affecté », a admis Pichai, traduisant la difficulté pour les géants technologiques de concilier innovation dans l’IA et responsabilité environnementale. Cette tension entre impératifs technologiques et écologiques devient l’un des défis majeurs de l’industrie numérique contemporaine.
L’entraînement des modèles d’IA générative requiert des quantités astronomiques de puissance de calcul. Les centres de données, déjà grands consommateurs d’énergie, voient leur demande exploser pour répondre aux besoins de ces technologies gourmandes en ressources. Les applications bénéfiques de l’IA, comme la prévision des ouragans, doivent être mises en balance avec ce coût environnemental considérable. Chaque requête adressée à un assistant conversationnel sophistiqué consomme plusieurs fois plus d’énergie qu’une recherche web classique, multipliant l’empreinte carbone du secteur numérique.
Les solutions envisagées pour réduire l’empreinte écologique de l’IA
Face à ce défi énergétique majeur, l’industrie technologique explore diverses pistes pour atténuer l’impact environnemental de l’intelligence artificielle. Sundar Pichai a évoqué la nécessité de développer de nouvelles sources d’énergie et de renforcer les infrastructures du secteur. Cette approche reflète une prise de conscience croissante que la viabilité à long terme de l’IA dépend de sa capacité à s’inscrire dans une démarche soutenable sur le plan environnemental. Les investissements dans les énergies renouvelables deviennent ainsi indissociables des investissements dans l’IA elle-même.
Plusieurs axes d’amélioration se dessinent progressivement. L’optimisation des algorithmes permet de réduire substantiellement la quantité de calculs nécessaires pour obtenir des résultats équivalents. Les architectures de puces spécialisées dans l’IA offrent également des gains d’efficacité énergétique significatifs par rapport aux processeurs généralistes. Parallèlement, la conception de centres de données plus efficients, utilisant des systèmes de refroidissement innovants et situés dans des zones géographiques propices aux énergies renouvelables, contribue à diminuer l’empreinte carbone globale. L’évolution future de la recherche en ligne devra nécessairement intégrer ces contraintes énergétiques.
| Solution technologique | Réduction énergétique potentielle | Délai de déploiement |
|---|---|---|
| Puces spécialisées IA | 40-60% | 2-3 ans |
| Optimisation algorithmique | 30-50% | Immédiat |
| Refroidissement liquide avancé | 25-35% | 3-5 ans |
| Centres de données nouvelle génération | 50-70% | 5-7 ans |
| Énergies renouvelables dédiées | 80-95% (émissions) | Variable |

- Investissements massifs dans le solaire et l’éolien : les géants technologiques financent des parcs entiers d’énergies renouvelables
- Recherche sur les architectures frugales : développement de modèles d’IA plus légers mais tout aussi performants
- Mutualisation des infrastructures : partage de ressources de calcul pour éviter la duplication inutile
- Utilisation de la chaleur résiduelle : récupération de la chaleur des centres de données pour chauffer des bâtiments
- Localisation stratégique : implantation dans des régions froides réduisant les besoins en climatisation
Les transformations radicales du monde du travail face à l’essor de l’intelligence artificielle
La mise en garde de Sundar Pichai ne se limite pas aux dimensions financières et environnementales de la révolution de l’intelligence artificielle. Le patron de Google a également abordé frontalement les implications sociétales de cette transformation technologique, notamment sur l’emploi et l’organisation du travail. « Nous devrons gérer des perturbations sociétales », a-t-il reconnu, tout en soulignant que ces bouleversements « créeront aussi de nouvelles opportunités ». Cette vision nuancée reflète la complexité d’une situation où l’IA promet simultanément d’automatiser de nombreuses tâches et d’ouvrir de nouveaux horizons professionnels.
La transformation des métiers constitue probablement l’un des aspects les plus sensibles de l’avènement de l’intelligence artificielle. Contrairement aux discours rassurants qui minimisent l’impact sur l’emploi, Pichai reconnaît explicitement que le développement de l’IA « fera évoluer et transformer certains emplois, et les gens devront s’adapter ». Cette évolution ne sera pas uniforme : certains secteurs connaîtront des mutations profondes tandis que d’autres resteront relativement préservés. Les professions intellectuelles, longtemps considérées comme à l’abri de l’automatisation, se trouvent désormais en première ligne de cette disruption technologique.
Selon le dirigeant d’Alphabet, la clé de la réussite professionnelle dans ce nouvel environnement résidera dans la capacité à maîtriser les outils d’intelligence artificielle. « Peu importe que vous vouliez être enseignant ou médecin. Toutes ces professions existeront encore, mais ceux qui réussiront dans chacune d’elles seront ceux qui apprendront à utiliser ces outils », a-t-il affirmé. Cette vision dessine un futur où l’IA ne remplace pas les humains mais augmente leurs capacités, créant une division entre ceux qui sauront l’exploiter et ceux qui resteront à l’écart de cette évolution. Les assistants personnels intelligents illustrent déjà comment l’IA s’intègre dans notre quotidien professionnel.
Quels métiers seront les plus affectés par l’intelligence artificielle
L’analyse des secteurs les plus exposés aux transformations induites par l’intelligence artificielle révèle un paysage contrasté. Les professions impliquant des tâches répétitives, même complexes, se trouvent en première ligne. Paradoxalement, certains emplois qualifiés sont plus menacés que des métiers manuels qui requièrent dextérité et adaptabilité situationnelle. Les analystes financiers, les traducteurs, les rédacteurs de contenus standardisés ou encore les assistants juridiques voient leurs activités profondément remises en question par l’émergence de systèmes capables d’effectuer leurs tâches avec une rapidité et une précision accrues.
Le secteur médical illustre parfaitement cette ambivalence. L’IA excelle dans l’analyse d’imagerie médicale, détectant parfois des anomalies que l’œil humain peine à identifier. Pour autant, le métier de médecin ne disparaît pas ; il se transforme. Les praticiens devront intégrer ces outils diagnostiques tout en conservant leurs compétences relationnelles et leur capacité de jugement global sur le patient. Cette hybridation entre expertise humaine et assistance artificielle définit le nouveau paradigme professionnel. La protection des données face à l’IA devient également une compétence cruciale dans de nombreux métiers.
| Secteur professionnel | Niveau d’impact IA | Type de transformation |
|---|---|---|
| Analyse de données | Très élevé | Automatisation partielle + augmentation |
| Service client | Élevé | Automatisation progressive des requêtes simples |
| Création de contenu | Modéré à élevé | Assistance à la production, supervision humaine nécessaire |
| Enseignement | Modéré | Personnalisation des apprentissages, rôle pédagogique maintenu |
| Artisanat et métiers manuels | Faible | Impact limité à court terme |
- Phase d’émergence : introduction progressive de l’IA comme outil d’assistance dans les tâches spécifiques
- Phase d’intégration : généralisation de l’usage quotidien, formation massive des professionnels aux nouveaux outils
- Phase de transformation : redéfinition des compétences essentielles et évolution des cursus de formation
- Phase de stabilisation : émergence d’un nouvel équilibre entre capacités humaines et artificielles
- Phase d’adaptation continue : apprentissage permanent face aux évolutions technologiques constantes
Les stratégies des entreprises pour naviguer dans l’incertitude du marché de l’IA
Face aux risques évoqués par le PDG de Google concernant un possible éclatement de la bulle de l’intelligence artificielle, les entreprises du secteur technologique et au-delà doivent élaborer des stratégies robustes pour se prémunir contre une correction brutale du marché. L’investissement massif dans l’IA, bien qu’incontournable pour rester compétitif, doit s’accompagner d’une gestion prudente des ressources et d’une diversification des activités. Les sociétés qui concentrent l’intégralité de leur modèle économique sur des promesses technologiques non encore rentables s’exposent à des risques considérables en cas de retournement du sentiment des investisseurs.
Les grandes entreprises technologiques adoptent progressivement une approche plus mesurée, cherchant à équilibrer innovation et rentabilité. Cette prudence contraste avec l’euphorie des premiers mois de l’explosion de l’IA générative. Les dirigeants réalisent que la soutenabilité financière à long terme nécessite de générer des revenus concrets plutôt que de se reposer uniquement sur des valorisations spéculatives. L’émergence d’alternatives aux moteurs de recherche traditionnels montre comment le paysage technologique évolue rapidement, obligeant les acteurs établis à repenser leurs stratégies.
La diversification des sources de revenus devient une priorité stratégique. Les entreprises cherchent à monétiser rapidement leurs investissements en IA en proposant des services payants, des licences technologiques ou des solutions d’entreprise. Cette course à la rentabilisation peut toutefois créer des tensions avec les objectifs de recherche fondamentale à long terme. Le risque d’une commercialisation prématurée de technologies insuffisamment matures pourrait décevoir les utilisateurs et ternir la réputation de l’ensemble du secteur, accélérant potentiellement l’éclatement de la bulle tant redoutée.
Les indicateurs à surveiller pour anticiper une correction du marché
Les investisseurs et dirigeants d’entreprises attentifs scrutent désormais une série d’indicateurs susceptibles de signaler un retournement imminent du marché de l’intelligence artificielle. Le premier d’entre eux concerne l’évolution des valorisations par rapport aux revenus effectifs. Lorsque l’écart entre les promesses et les réalisations concrètes devient trop important, une correction devient inévitable. Les entreprises dont la capitalisation boursière repose essentiellement sur des projections optimistes plutôt que sur des fondamentaux solides représentent les cibles les plus vulnérables en cas de changement de sentiment du marché.
Le niveau d’endettement des startups et des entreprises technologiques constitue un autre signal crucial. Dans un contexte de taux d’intérêt qui ont considérablement augmenté ces dernières années, le financement par la dette devient plus coûteux. Les entreprises qui ont massivement emprunté pour financer leurs développements en IA pourraient se retrouver en difficulté si leurs revenus ne décollent pas suffisamment rapidement. Cette fragilité financière pourrait déclencher une cascade de faillites, entraînant dans leur sillage même des acteurs plus solides par effet de contagion. L’évolution du trafic vers les médias via Google Discover illustre comment les modèles économiques numériques restent volatils.
- Ralentissement des levées de fonds : une diminution du volume d’investissement signalerait un refroidissement du marché
- Augmentation des délais de rentabilité : reports répétés des objectifs financiers par les entreprises du secteur
- Consolidation sectorielle : multiplication des acquisitions d’urgence et des fusions défensives
- Réduction des effectifs : vagues de licenciements chez les acteurs majeurs pour préserver leurs marges
- Désengagement des investisseurs institutionnels : baisse des allocations des fonds vers le secteur technologique
- Multiplication des échecs commerciaux : produits d’IA ne rencontrant pas leur public malgré les moyens déployés
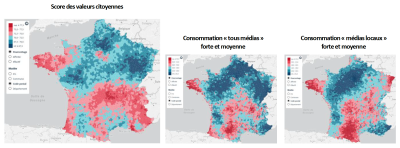
| Indicateur de marché | Seuil d’alerte | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Ratio valorisation/chiffre d’affaires | Supérieur à 20:1 | Correction boursière probable |
| Taux de combustion du cash | Moins de 18 mois de réserves | Risque de faillite accru |
| Nombre d’introductions en bourse | Baisse de 40% sur un trimestre | Perte de confiance des marchés |
| Révisions à la baisse des prévisions | Plus de 30% des entreprises concernées | Début de correction sectorielle |
L’équilibre délicat entre innovation technologique et responsabilité économique
L’alerte lancée par Sundar Pichai sur les risques d’éclatement de la bulle de l’intelligence artificielle soulève une question fondamentale : comment concilier la nécessité d’innover rapidement dans un domaine stratégique avec la prudence économique indispensable pour éviter une crise systémique? Cette tension traverse l’ensemble de l’écosystème technologique. Les entreprises qui ralentissent leurs investissements risquent de se faire distancer par leurs concurrents, tandis que celles qui poursuivent une croissance effrénée s’exposent à des vulnérabilités financières majeures en cas de retournement du marché.
Le rôle des régulateurs devient crucial dans ce contexte d’incertitude. Les autorités de surveillance financière observent avec attention l’évolution du secteur, conscientes qu’un effondrement brutal pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la seule industrie technologique. Les interconnexions entre les géants de la tech et le reste de l’économie, notamment via les investissements institutionnels et les fonds de pension, créent des risques systémiques que les décideurs publics doivent prendre en compte. Les évolutions potentielles des modèles de recherche en ligne montrent que même les positions dominantes peuvent être remises en question.
La transparence sur les capacités réelles et les limites de l’intelligence artificielle apparaît comme un enjeu majeur pour assainir le marché. Trop souvent, les communications des entreprises technologiques entretiennent une confusion entre les avancées scientifiques effectivement réalisées et les projections optimistes sur les développements futurs. Cette ambiguïté alimente les valorisations excessives et prépare le terrain pour des désillusions massives. Une communication plus factuelle et nuancée permettrait aux investisseurs d’évaluer plus rationnellement les opportunités et les risques, réduisant ainsi la probabilité d’une bulle spéculative incontrôlable.
Les leçons des précédentes bulles technologiques
L’histoire des technologies offre de précieux enseignements sur les mécanismes des bulles spéculatives et leurs conséquences. La bulle Internet de la fin des années 1990 demeure l’exemple le plus emblématique de cette dynamique d’euphorie suivie d’effondrement. À l’époque, la simple présence du suffixe « .com » dans le nom d’une entreprise suffisait à décupler sa valorisation, indépendamment de toute logique économique. Lorsque la réalité a rattrapé les fantasmes, l’effondrement a été brutal, effaçant des milliers de milliards de dollars de capitalisation et précipitant l’économie mondiale dans la récession.
Pourtant, la bulle Internet n’a pas signifié la fin du numérique, bien au contraire. Après l’assainissement du marché, les entreprises solides dotées de véritables modèles économiques ont prospéré, transformant effectivement le monde comme les visionnaires l’avaient prédit, mais sur une période plus longue et de manière moins linéaire qu’imaginé. Cette trajectoire en forme de « J » – chute brutale puis montée progressive – pourrait caractériser également l’évolution de l’intelligence artificielle. Les promesses de transformation ne sont pas nécessairement exagérées sur le fond, mais leur temporalité et leur ampleur à court terme font probablement l’objet d’anticipations irréalistes. Les innovations technologiques régulières rappellent que le progrès technique suit rarement une courbe exponentielle ininterrompue.
- Phase d’émergence technologique : découverte d’une innovation potentiellement disruptive générant un intérêt initial
- Phase d’enthousiasme excessif : multiplication des projets et des investissements, valorisations déconnectées des réalités
- Phase de réalité décevante : les premières applications concrètes déçoivent par rapport aux attentes démesurées
- Phase de correction : effondrement des valorisations, disparition des acteurs les plus fragiles
- Phase de maturation : consolidation du secteur, émergence de modèles économiques viables
- Phase d’intégration : la technologie devient partie intégrante de l’économie sans battage médiatique excessif
| Bulle technologique | Période | Perte de capitalisation maximale | Durée de récupération |
|---|---|---|---|
| Dot-com | 1995-2002 | 78% (Nasdaq) | 15 ans |
| Télécommunications | 1998-2003 | 95% (certains acteurs) | 10+ ans |
| Cryptomonnaies | 2017-2018 | 83% (Bitcoin) | 3 ans |
| Technologies propres 1.0 | 2006-2011 | 92% (indice sectoriel) | 8 ans |
- Distinction entre vision à long terme et réalité à court terme : les transformations profondes prennent des décennies
- Importance des fondamentaux économiques : aucune technologie ne dispense de générer des bénéfices durables
- Rôle de la sélection naturelle : les crises éliminent les acteurs les moins robustes, renforçant l’écosystème
- Nécessité d’une infrastructure mature : l’adoption massive requiert des fondations technologiques et réglementaires solides
- Volatilité inhérente à l’innovation : les parcours technologiques comportent toujours des phases d’euphorie et de désillusion
Les parallèles entre la situation actuelle de l’intelligence artificielle et les bulles passées sont frappants mais non parfaitement superposables. L’IA repose sur des avancées scientifiques substantielles et démontre quotidiennement des capacités impressionnantes. Contrairement aux promesses purement spéculatives de certaines startups dot-com, les grands modèles de langage ou les systèmes de reconnaissance d’images fonctionnent effectivement et créent de la valeur. La question n’est donc pas de savoir si l’IA transformera l’économie – elle le fera indubitablement – mais plutôt de déterminer si les valorisations actuelles reflètent correctement le calendrier et l’ampleur de cette transformation. Les améliorations continues des outils comme Google Traduction témoignent de progrès réels et mesurables, loin des promesses vides de substance qui caractérisaient certaines bulles antérieures.
Qu’est-ce qu’une bulle spéculative dans le secteur technologique?
Une bulle spéculative technologique se caractérise par une augmentation rapide et excessive des valorisations d’entreprises du secteur, déconnectée de leurs performances financières réelles. Les investisseurs, craignant de manquer une opportunité majeure, acceptent des prix irrationnellement élevés basés sur des promesses futures plutôt que sur des résultats concrets. Cette dynamique crée une inflation artificielle des prix qui finit généralement par éclater lorsque la réalité économique rattrape les anticipations excessives.
Pourquoi l’intelligence artificielle consomme-t-elle autant d’énergie?
L’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, particulièrement les grands modèles de langage, nécessite des calculs extrêmement complexes effectués sur des milliers de processeurs fonctionnant simultanément pendant des semaines ou des mois. Ces opérations génèrent une chaleur considérable qui doit être dissipée par des systèmes de refroidissement énergivores. De plus, une fois déployés, ces modèles consomment de l’énergie à chaque requête traitée, ce qui, multiplié par des millions d’utilisateurs quotidiens, représente une charge énergétique massive sur les infrastructures mondiales.
Comment l’IA va-t-elle transformer les métiers existants?
L’intelligence artificielle ne remplacera pas simplement les travailleurs mais modifiera profondément la nature des tâches et des compétences requises. Les activités routinières et répétitives, même intellectuelles, seront automatisées, permettant aux professionnels de se concentrer sur les aspects créatifs, relationnels et décisionnels de leur métier. La maîtrise des outils d’IA deviendra une compétence transversale indispensable, créant une division entre ceux qui sauront exploiter ces technologies pour augmenter leur productivité et ceux qui resteront à l’écart de cette évolution. Les formations continues et l’adaptation permanente deviendront essentielles pour maintenir son employabilité.
Que se passerait-il concrètement si la bulle de l’IA éclatait?
Un éclatement de la bulle de l’IA entraînerait une correction massive des valorisations des entreprises technologiques, avec des chutes boursières potentiellement supérieures à 50% pour les acteurs les plus exposés. De nombreuses startups sans revenus substantiels feraient faillite, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs. Les entreprises technologiques réduiraient drastiquement leurs investissements en IA et leurs effectifs. Cependant, comme lors des précédentes bulles, les acteurs solides avec des modèles économiques viables survivraient et prospéreraient après l’assainissement du marché, permettant une croissance plus saine et durable du secteur à long terme.
Les géants technologiques comme Google peuvent-ils vraiment être affectés par un éclatement de la bulle?
Bien que disposant de ressources financières considérables et de revenus diversifiés, même les géants comme Google seraient impactés par un éclatement de la bulle de l’IA. Leurs valorisations boursières chuteraient, réduisant leur capacité d’investissement et affectant la richesse de leurs actionnaires. Ils devraient revoir leurs ambitions à la baisse, réduire leurs dépenses de recherche et développement, et potentiellement procéder à des licenciements. Toutefois, leur solidité financière leur permettrait de traverser la crise mieux que la plupart de leurs concurrents plus fragiles, et ils émergeraient probablement renforcés en position relative après l’élimination des acteurs les plus faibles du marché.