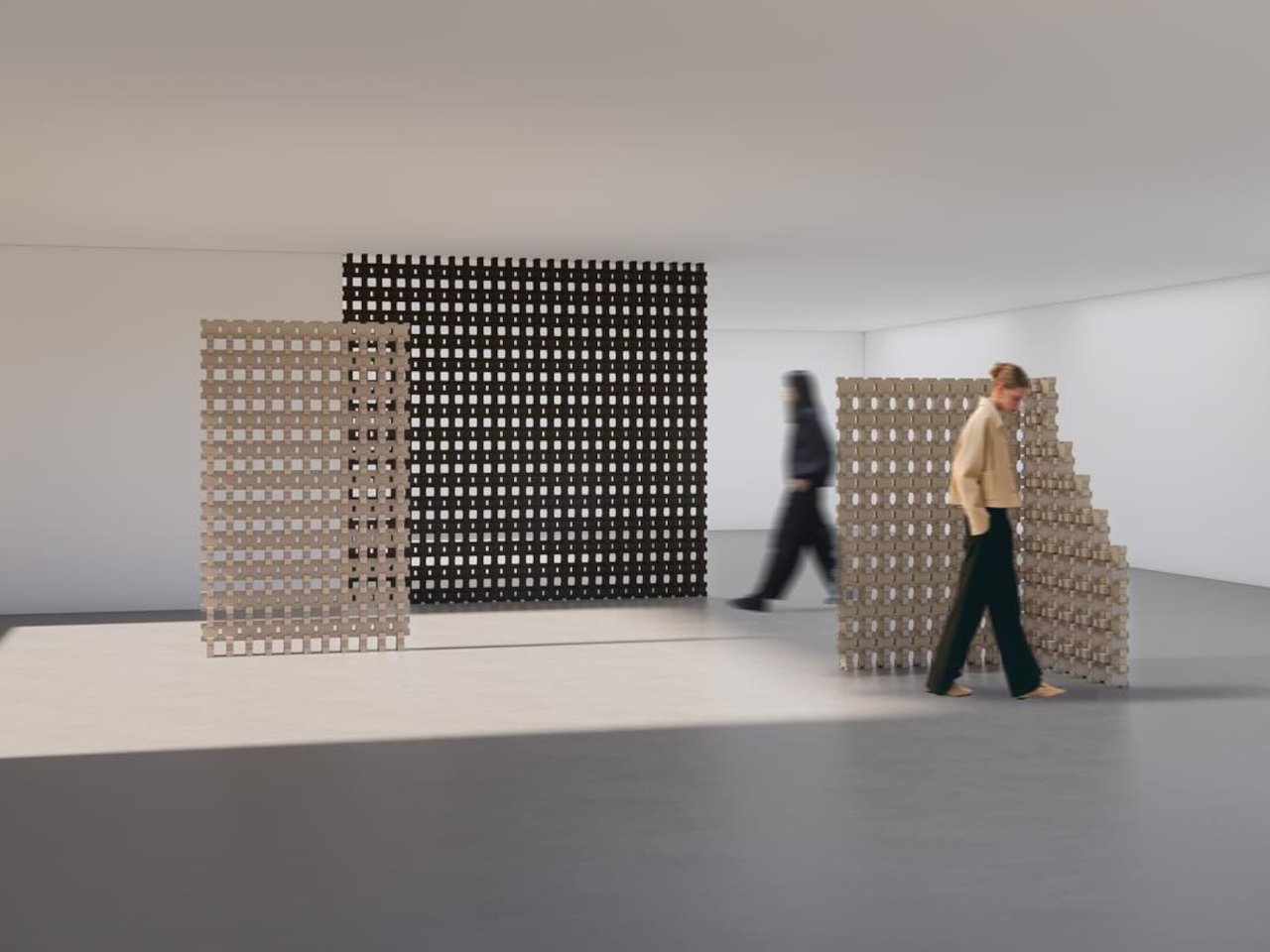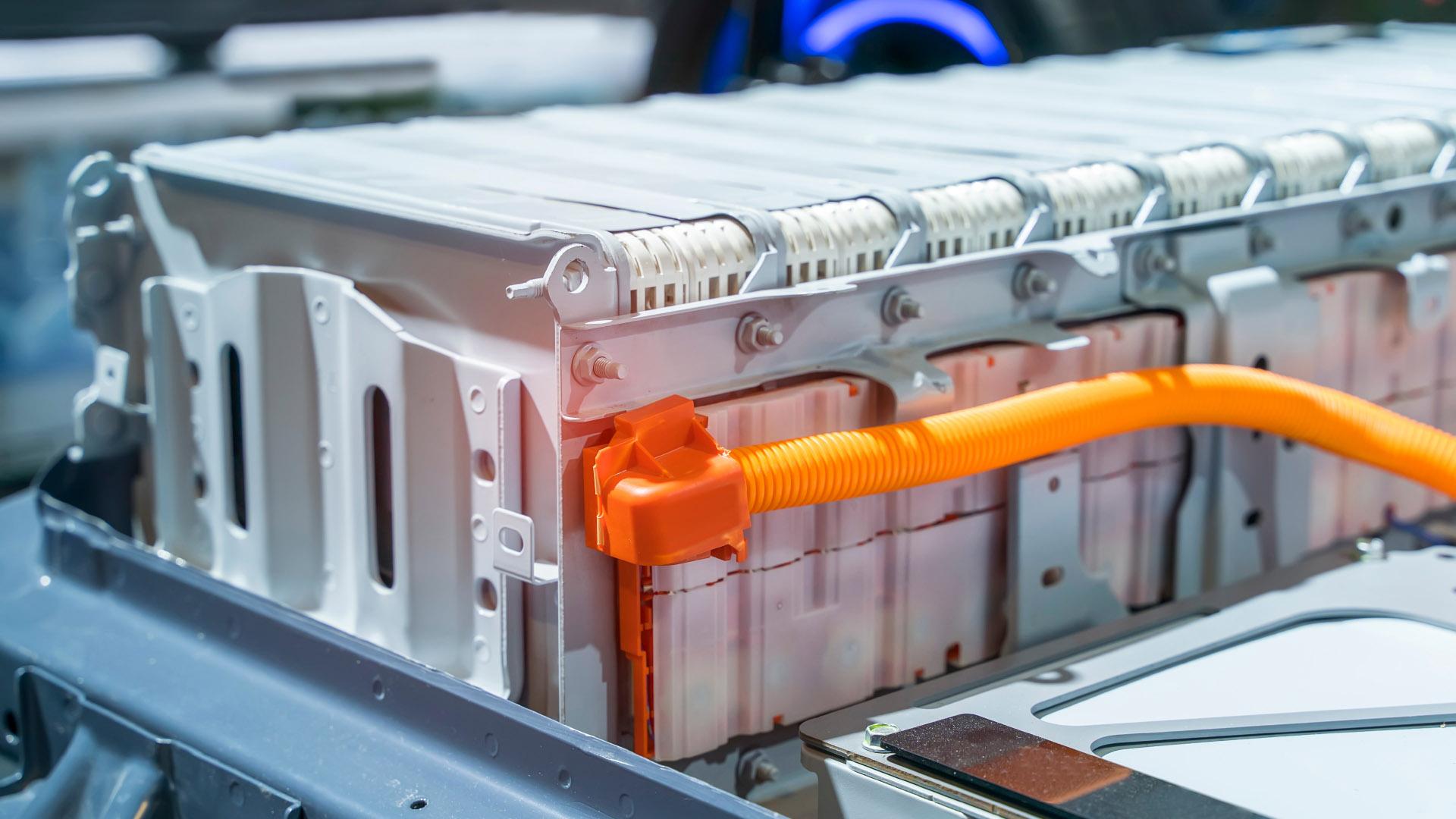Dans un monde en quête de solutions énergétiques durables, l’idée visionnaire de Peter Glaser sur les panneaux solaires en orbite refait surface. Face à l’urgence climatique, un nouveau rapport académique dévoile le potentiel de cette technologie révolutionnaire pour transformer le système électoral européen. Explorez ce futur prometteur.
L’émergence de l’énergie solaire spatiale : une nouvelle ère pour la production d’énergie

Qu’est-ce que l’énergie solaire spatiale et son retour sur le devant de la scène
L’énergie solaire et éolienne terrestre sont efficaces, mais leur production est intermittente, conditionnée par le climat et le cycle jour-nuit. L’énergie solaire spatiale (SBSP, pour Solar Space-Based Power) propose une solution innovante en utilisant des satellites placés en orbite géostationnaire. Dans cet environnement, la lumière solaire est quasi constante et les pertes dues à l’atmosphère sont minimisées, permettant une production d’énergie ininterrompue.
Ces satellites, situés à environ 36 000 kilomètres de la surface terrestre, seraient capables d’orienter leurs surfaces afin de capter efficacement la radiance solaire et de la transmettre à la Terre à l’aide de micro-ondes dirigées vers des stations de réception spécifiques.
Nouveaux résultats d’analyse
Une étude menée par le King’s College London et publiée dans la revue scientifique Joule a simulé un système énergétique européen décarbonisé d’ici 2050 avec et sans l’intégration de la SBSP. Les résultats indiquent que si certains seuils de coûts sont atteints, l’énergie provenant de l’orbite pourrait réduire le coût total du système électrique de 7 % à 15 %.
Ce modèle suggère également que la SBSP pourrait réduire jusqu’à 80 % de la capacité éolienne et solaire terrestre en plus de diminuer l’utilisation de batteries de plus de 70 %, tout en maintenant la nécessité d’une conservation énergétique saisonnière, notamment au moyen d’hydrogène durant certains hivers. En termes économiques, l’évaluation du potentiel d’économie pourrait atteindre des dizaines de milliards d’euros par an.
Deux conceptions architecturales : heliostats et matrice plane
Le groupe de recherche a étudié deux concepts développés par la NASA. Le premier, le plus ambitieux, est un essaim de heliostats, qui consiste en des modules de type « ruche » équipés de plusieurs réflecteurs hexagonaux redirigeant la lumière vers un concentrateur central. Cette conception permettrait une disponibilité énergétique presque continue, atteignant environ 99 %, mais implique des avancées technologiques et logistiques significatives.
Le second concept, appelé matrice plane, représente une architecture plus traditionnelle de satellite, où une face capte la lumière et l’autre la transmet. Bien que cette conception soit plus simple et plus proche de la démonstration, son efficacité se situe autour de 60 %, un net progrès par rapport aux 15-30 % habituels des panneaux solaires terrestres, mais en deçà de l’essaim d’heliostats.
Fonctionnement : de l’orbite au réseau électrique
Le fonctionnement de ce système s’apparente à celui d’un satellite de communication, mais optimisé pour la production d’énergie. Dans un premier temps, le satellite est lancé et déployé dans l’orbite géostationnaire, suivi par sa stabilisation et son étalonnage. Après cela, les panneaux ou réflecteurs ajustent de manière autonome leurs surfaces pour capter la radiance solaire en continu ; l’électricité générée est convertie en micro-ondes de manière très efficace.
Un faisceau d’énergie est alors acheminé vers la Terre avec un contrôle précis de la phase et de la direction, afin d’atteindre de grandes rectenas (stations de réception de plusieurs kilomètres carrés) où le signal est reconverti en électricité utilisable. Cette électricité peut ensuite être injectée dans le réseau ou stockée, en fonction de la demande. L’ensemble du processus exige une synchronisation méticuleuse, une gestion thermique avancée, ainsi que des systèmes de sécurité garantissant que la densité de puissance du faisceau reste à des niveaux régulés.
Coûts, délais et conditions de viabilité
Un aspect crucial de l’étude concerne les hypothèses de coût. Pour être compétitive, l’architecture des heliostats doit atteindre un coût unitaire proche de 14 fois celui des panneaux solaires terrestres projetés pour 2050 ; quant à la matrice plane, elle devra se situer autour de 9 fois. Actuellement, ces chiffres sont encore éloignés des objectifs visés.
En plus du matériel, plusieurs étapes critiques doivent être franchies : des tests à grande échelle concernant la transmission sans fil de l’énergie, l’assemblage robotisé en orbite, la logistique de maintenance et la gestion des déchets spatiaux. À cela s’ajoutent des cadres réglementaires pour garantir la sécurité des faisceaux, la coordination de l’espace aérien et la protection de l’astronomie.
Opinions des experts
Les scientifiques saluent le sérieux économique de l’analyse, mais soulignent qu’elle ne répond pas à la question du comment. L’astronome Olga Zamora évoque des préoccupations concernant la construction, les lancements, l’assemblage en orbite, les déchets spatiaux, la réglementation et les impacts potentiels sur l’observation astronomique. Le climatologue Pep Canadell souligne que la technologie n’est pas encore prête à être déployée à grande échelle et nécessite un investissement considérable en recherche et développement, sans garantie de succès. Il recommande de stimuler les recherches en SBSP tout en poursuivant le déploiement des énergies renouvelables établies et du stockage déjà opérationnel.
Une feuille de route par étapes
Le même rapport propose une approche progressive : commencer par des démonstrateurs de matrice plane, plus réalisables à court terme, parallèlement à l’accélération du développement de l’essaim d’heliostats. Dans le même temps, la réduction des coûts de lancement et l’évolution de la robotique en orbite seront essentiels.
Au niveau européen, des initiatives telles que Solaris (ESA) montrent un intérêt grandissant pour cette voie, tandis que des pays comme Chine, Japon, États-Unis, Inde, Royaume-Uni et Russie s’engagent également dans cette direction. Si la SBSP progresse, elle pourrait renforcer la sécurité d’approvisionnement énergétique et contribuer à l’objectif de zéro émission nette d’ici le milieu de ce siècle.
La promesse de transformer l’espace en une centrale solaire à fonctionnement continu est aussi attrayante qu’exigeante : bien qu’il existe un potentiel pour réduire les coûts du système et stabiliser le réseau, des barrères techniques, économiques et sociales persistent, rendant crucial un équilibre entre ambition et prudence tout en continuant à exploiter les solutions terrestres déjà efficaces.
Mon avis :
La réémergence de l’énergie solaire spatiale (SBSP) présente des avantages potentiels, comme une réduction de 7 à 15 % des coûts du système électrique en Europe d’ici 2050 et une délocalisation de 80 % de la capacité terrestre, mais elle fait face à des défis technologiques et financiers importants, nécessitant des avancées significatives et des réglementations claires pour la rendre viable.
Les questions fréquentes :
Qu’est-ce que l’énergie solaire spatiale (SBSP) ?
L’énergie solaire spatiale (SBSP) consiste à placer des satellites en orbite géostationnaire pour capter la lumière du soleil de manière continue, sans pertes atmosphériques. Ces satellites convertissent la lumière en électricité et transfèrent l’énergie vers la Terre sous forme de micro-ondes, visant à surmonter l’intermittence des sources d’énergie renouvelables terrestres comme le solaire et l’éolien.
Quels sont les avantages du nouveau modèle d’analyse ?
Un récent étude menée par le King’s College London a simulé un système énergétique européen décarbonisé d’ici 2050. Les résultats indiquent que si les coûts de la SBSP atteignent des seuils spécifiques, elle pourrait réduire le coût total du système électrique de 7 % à 15 %. De plus, elle pourrait remplacer jusqu’à 80 % de la capacité des énergies éolienne et solaire terrestres, diminuant ainsi la dépendance aux batteries.
Quelles architectures sont à l’étude pour la SBSP ?
Deux concepts principaux sont évalués : les heliostats, qui sont des modules complexes avec plusieurs réflecteurs redirigeant la lumière vers un concentrateur, et une matrice planar plus conventionnelle. Les heliostats promettent une disponibilité énergétique proche de 99 %, tandis que la matrice planar a une disponibilité d’environ 60 %. Cependant, les premiers nécessitent des avancées technologiques significatives.
Quelles sont les principales barreaux à surmonter pour rendre la SBSP viable ?
Pour que la SBSP soit compétitive, le coût unitaire des heliostats devrait s’approcher de 14 fois le coût prévu des panneaux terrestres d’ici 2050, tandis que la matrice planar devrait atteindre environ 9 fois ce coût. Des tests à grande échelle, des avancées en logistique spatiale et des régulations appropriées sont également nécessaires pour résoudre les incertitudes liées à la construction et aux impacts environnementaux.