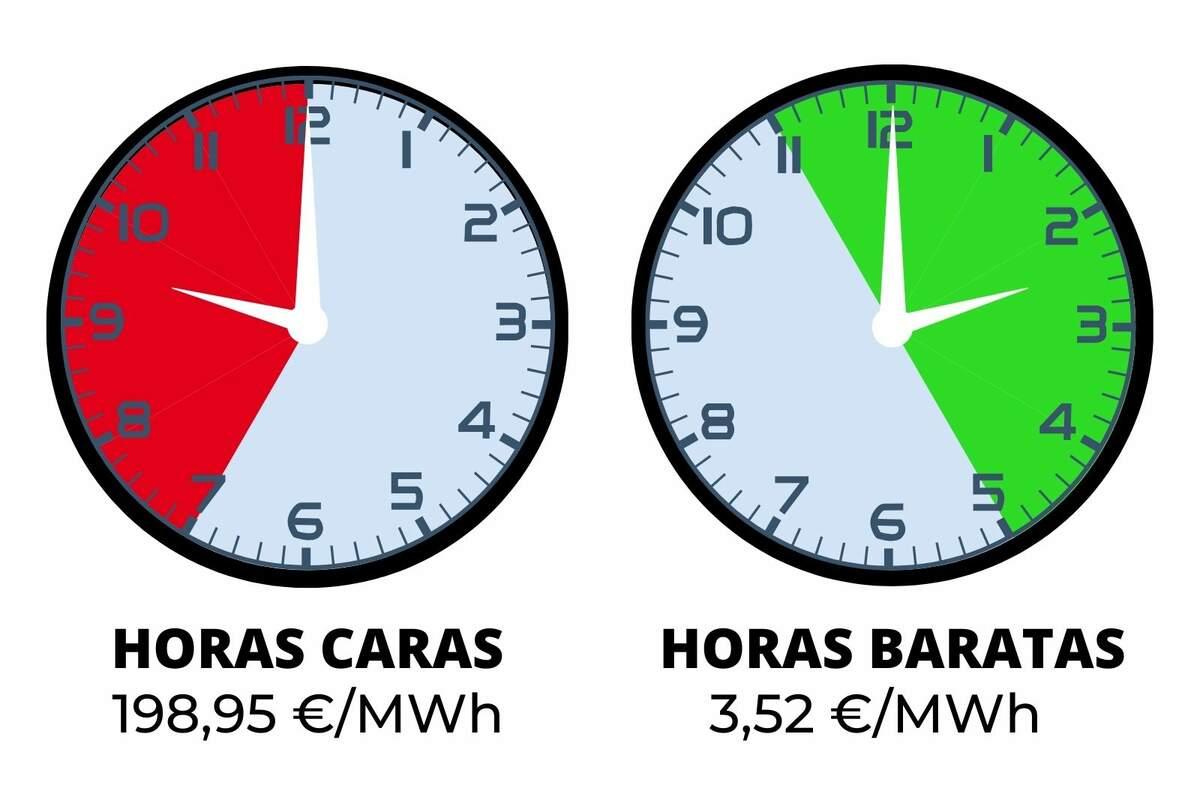La pollution marine par les plastiques représente une crise écologique majeure, aggravée par la libération de toxines dans les océans. Cependant, des avancées passionnantes émergent grâce à des chercheurs de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) qui découvrent des bactéries marines capables de dégrader ces polluants, offrant une lueur d’espoir pour la bioremédiation.
Biodegradation du plastique : Ce que la science sait et comment l’appliquer
La présence massive de plastiques dans les océans constitue une forme de pollution marine qui dépasse largement ce que l’on peut observer à l’œil nu. En plus des filets, des emballages ou des microplastiques, l’océan subit une pluie constante de composés chimiques libérés par le plastique au fil du temps. Ces composés nocifs, appelés lixiviats, représentent une menace réelle pour l’environnement. Toutefois, certaines bactéries marines semblent avoir commencé à utiliser ces substances comme source de nourriture. Ce phénomène ouvre des perspectives intéressantes pour la bioremédiation, bien que le temps presse face à l’énorme volume de déchets qui arrive chaque année dans les eaux de notre planète.
Un autre axe de recherche scientifique se concentre sur l’identification d’enzymes marines capables de décomposer des polymères comme le PET (polyéthylène téréphtalate), que l’on retrouve dans les bouteilles et les textiles. Un motif structurel clé, nommé M5, permet de distinguer les PETases fonctionnelles des variantes inactives de l’océan. Cette combinaison de découvertes — bactéries consommant des lixiviats et enzymes attaquant les polymères — dessine des voies complémentaires pour réduire l’impact de la pollution plastique, des eaux méditerranéennes jusqu’aux profondeurs abyssales.
La pollution plastique dans l’océan : contexte et urgence
Dans la mer Méditerranée, la densité de fragments plastiques a atteint des niveaux alarmants, équivalant à une surface affectée de 7 500 terrains de football. Au-delà de l’impact visuel, la gravité réside dans la diversité des types de pollution de l’eau, car ces objets libèrent des additifs et des produits de dégradation qui se dissolvent dans l’eau.
Ce processus de libération de composés est désigné par le terme lixiviation. Lorsque le plastique entre en contact avec l’eau de mer, des molécules se détachent, certaines ayant des effets nuisibles sur la biote marine. La lumière du soleil accélère ce processus : les plastiques qui restent à la surface lixivient davantage que ceux qui sont immergés, rendant ainsi ces "îles" de déchets un problème tant physique que chimique.
L’ampleur du problème est mondiale, avec des estimations indiquant que entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans l’océan, dépassant de loin sa capacité naturelle d’assimilation. Attendre que l’océan se "nettoie tout seul" à ce rythme est illusoire, d’où la nécessité de solutions biologiques et industrielles complémentaires.
Dans ce contexte, les stratégies de bioremédiation naturelle — qui exploitent l’activité des micro-organismes — émergent comme une voie prometteuse, à condition de bien comprendre leurs limites. L’objectif n’est pas de relâcher des microbes dans l’océan sans contrôle, mais de déterminer des processus et des outils utilisables de manière réfléchie.
Bactéries marines qui exploitent les lixiviats du plastique
L’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) a identifié des groupes de bactéries capables de consommer des composés chimiques libérés lors de la dégradation du plastique en milieu salin. Contrairement à de nombreux travaux antérieurs centrés sur la dégradation directe des polymères, cette étude se concentre sur les lixiviats comme source de carbone pour la croissance microbienne.
Les expériences ont utilisé du polyéthylène, le plastique le plus répandu dans l’océan, ainsi qu’un mélange de matériaux vieillissants collectés sur des plages comprenant du polyéthylène et du polypropylène. Grâce à des techniques comme CARD-FISH (pour identifier les groupes dominant), BONCAT (pour l’évaluation de l’activité de croissance) et la séquençation du gène 16S rRNA (pour déterminer la composition taxonomique), il a été constaté que certaines bactéries marines pouvaient transformer ces composés en CO2, en biomasse et en autres sous-produits.
Ce qui est intéressant, c’est que ces espèces, bien que décrites dans la littérature, n’avaient pas encore été associées à l’élimination des dérivés du plastique. Cette "nouvelle compétence" ouvre la voie à des applications biotechnologiques pour atténuer l’impact chimique, en particulier dans des zones où la radiation solaire intensifie la lixiviation.
Les découvertes ne rendent pas les lixiviats inoffensifs du jour au lendemain, mais elles suggèrent que certaines matières organiques dissoutes peuvent être métabolisées par la biocénose microbienne de l’océan. Cela représente un soulagement partiel, mais il est crucial de noter que le rythme d’entrée des déchets est énorme.
Enzymes PETase avec le motif M5 : la clé pour dégrader le PET
Parallèlement, un consortium international dirigé par KAUST a découvert une pièce essentielle pour différencier les PETases fonctionnelles de celles qui ne le sont pas : le motif M5. Après l’analyse de plus de 400 échantillons provenant des sept mers, près de 80 % contenaient des bactéries avec des versions enzymatiques portant ce motif. La signalisation M5 agit comme une marque structurale qui prédit l’activité réelle contre le PET.
Le secret réside dans la configuration tridimensionnelle. Les PETases avec le motif M5 reconnaissent et coupent les chaînes du polymère terephthalate de polyéthylène, fragmentant ainsi le matériau en produits susceptibles d’être valorisés par d’autres micro-organismes. Des variantes sans ce motif, souvent désignées comme pseudo-PETases, manquent de la catalyse appropriée. La différence est donc significative tant sur le plan cosmétique que fonctionnel.
Pour faire le tri entre les enzyme efficaces et inefficaces, l’équipe a combiné du modélisme structurel assisté par intelligence artificielle avec un criblage génétique et une validation en laboratoire. Seules les enzymes portant le motif M5 ont montré des dégradations mesurables du PET dans des conditions contrôlées, avec des efficacités atteignant parfois entre 25 % et 50 % par rapport à la PETase originale décrite en 2016.
Autres micro-organismes dégradateurs : du polyuréthane à PHB
La capacité microbienne à décomposer les plastiques n’est pas limitée au PET. Au Japon, une bactérie nommée Ideonella sakaiensis a été identifiée pour sa capacité à transformer le PET en PHB, un polymère hautement biodégradable. Cette découverte ouvre des pistes pour les bioplastiques et l’innovation à valeur ajoutée.
En Allemagne, l’isolement d’une souche de Pseudomonas sp. TDA1 a mis en lumière sa capacité à dégrader les composants de base du polyuréthane, un plastique courant dans les isolants et les meubles, mais difficile à recycler. La rupture des liaisons du polyuréthane pour les utiliser comme carbone, azote et énergie démontre une flexibilité métabolique méritant d’être explorée dans le cadre de processus industriels.
Des recherches ont également montré que le champignon du sol, Aspergillus tubingensis, peut éroder les surfaces du polyuréthane à l’aide d’enzymes, laissant des marques visibles en laboratoire. Dans les environnements marins, des champignons ont été détectés avec des capacités similaires contre le polypropylène, tandis que des genres bactériens tels que Pseudomonas et Lysinibacillus montrent une activité contre le HDPE et le PET. Cette panoplie d’outils biologiques s’élargit à plusieurs polymères courants.
Cependant, il est essentiel d’être prudent face à la tentation de croire en des solutions miracles. L’utilisation de bactéries ou de champignons à grande échelle nécessiterait leur culture à des concentrations très élevées, le contrôle de leur comportement et l’assurance qu’ils ne modifient pas les écosystèmes locaux. Tous les micro-organismes ne sont pas cultivables ni prévisibles, et une utilisation non régulée en mer n’est pas une option responsable.
Les défis à relever
La dégradation naturelle par les micro-organismes est trop lente pour compenser le flux annuel de déchets. La libération de plastiques en espérant que ceux-ci seront dégradés par des microbes est non seulement inefficace, mais aussi risquée pour les chaînes alimentaires et la biodiversité. Une approche intégrale, comprenant prévention, technologie et gestion adéquate, est impérative.
La réplicabilité en industrie de ce qui fonctionne en laboratoire est également complexe. La variabilité environnementale complique la catalyse et soulève des questions concernant des impacts écologiques non désirés, tels que de potentielles transferts génétiques. La sécurité environnementale doit primer sur l’enthousiasme biotechnologique, peu importe la tentation d’accélérer les processus.
Il apparaît logique de collecter les plastiques et de les traiter dans des installations spécifiques utilisant des enzymes ou des consortia microbien contrôlés. Pour assurer le succès de cette démarche, il faut également établir des systèmes efficaces de collecte et de séparation par polymères.
Seules des solutions multidimensionnelles permettront d’aborder cette problématique de manière constructive.
Mon avis :
La bioremédiation utilise des bactéries marines et des enzymes pour décomposer les plastiques en libérant des composés toxiques, proposée comme solution viable à la pollution océanique. Cependant, son efficacité est limitée par la vitesse de dégradation naturelle, exigeant des interventions coordonnées en matière de prévention et de gestion des déchets plastiques.
Les questions fréquentes :
Qu’est-ce que la lixiviation et comment affecte-t-elle les mers ?
La lixiviation est le processus par lequel des composés chimiques sont libérés lorsque le plastique entre en contact avec l’eau de mer. Ces molécules, certaines pouvant être toxiques, contaminent l’eau et affectent la biodiversité marine, augmentant ainsi la gravité de la pollution plastique.
Comment les bactéries marines aident-elles à réduire la pollution plastique ?
Certaines bactéries marines ont été identifiées comme capables de consommer les lixiviats libérés par le plastique. En transformant ces composés chimiques en CO2 et en biomasse, ces micro-organismes offrent une solution potentielle à la bioremédiation et aident à atténuer l’impact de la pollution plastique sur les océans.
Quel est le rôle des enzymes PETasa dans la dégradation du plastique ?
Les enzymes PETasa, notamment celles portant le motif M5, sont cruciales pour décomposer le polyéthylène téréphtalate (PET). Ces enzymes peuvent couper les chaînes de polymère en produits que d’autres microorganismes peuvent utiliser, représentant une approche prometteuse pour traiter les déchets plastiques.
Les plastiques dits « biodegradables » se décomposent-ils efficacement dans l’océan ?
Des études récentes montrent que le PLA, un plastique d’origine biologique considéré comme biodégradable, ne se décompose pas plus rapidement dans l’océan que d’autres plastiques comme le polystyrène. Il nécessite des températures élevées pour une dégradation efficace, ce qui n’est pas viable dans le milieu marin.